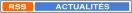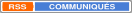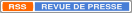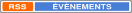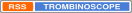Il faut relocaliser et déprolétariser le numérique - Pierre-Yves Gosset - Commission enquête suivi du Covid-19 - France insoumise
Titre : Il faut relocaliser et déprolétariser le numérique
Intervenant·e·s : Pierre-Yves Gosset - Sabine Rubin - Alexandre Schon
Lieu : Commission d’enquête de suivi du Covid-19 lancée par les parlementaires de la France insoumise
Date : 30 avril 2020
Durée : 1 h 17 min 38
Écouter ou enregistrer la vidéo ici ou ici
Licence de la transcription : Verbatim
Illustration : Logo de Framasoft par JosephK inspiré de la mascotte historique de LL. de Mars - Licence Creative Commons By-SA 2.0. Logo France insoumise Wikimedia Commons - Domaine public.
NB : transcription réalisée par nos soins, fidèle aux propos des intervenant·e·s mais rendant le discours fluide.
Les positions exprimées sont celles des personnes qui interviennent et ne rejoignent pas nécessairement celles de l'April, qui ne sera en aucun cas tenue responsable de leurs propos.
Transcription

Sabine Rubin : Bonjour à tous. Merci d’être présent Monsieur Gosset. Vous vous présenterez tout à l’heure.
Je rappelle simplement le cadre de ces auditions que nous menons à La France insoumise. Je m’occupe plus particulièrement d’auditionner toute la communauté éducative et tout ce qui a à voir avec l’enseignement dans cette période de confinement. L’idée est de pouvoir faire une analyse, d’avoir une réflexion sur cette crise, en l’occurrence aujourd’hui avec vous, avec ce Zoom, sur les outils informatiques, sur tout l’ensemble du numérique, numérique et école finalement.
Je vais laisser la parole à mon collègue Alexandre pour conduire cette audition très technique mais fondamentale pour la période que l’on vient de traverser et probablement pour l’avenir. Merci.
Alexandre Schon : Merci beaucoup Sabine.
Pierre-Yves Gosset, bonjour. Moi c’est Alexandre Schon, je suis animateur du livret numérique de la France insoumise, co-animateur. Juste pour vous repréciser, on a un programme général qui s’appelle L’Avenir en commun et autour de lui il y a une quarantaine de livrets thématiques dont le livret numérique qui sont en fait deux livrets qui traitent notamment des questions du Libre, de la licence globale et de ce genre d’éléments-là.
L’objectif de cette audition du groupe interparlementaire LFI c’est de rédiger un rapport global qui pourra servir dans la réflexion, dans les débats parlementaires, que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen. Et, dans ce cadre-là, on vous remercie vraiment beaucoup d’avoir accepté notre invitation à parler, notamment mais pas que, de la question du Libre aujourd’hui, à la fois dans la société, dans la période de confinement covid qu’on vit actuellement et, plus largement, de la place du logiciel libre, de l’ouvert et du domaine commun informationnel — vous pourrez nous expliquer plus simplement cette notion — dans le monde d’après que l’on appelle de nos vœux.
Pour vous présenter rapidement Framasoft1, Sabine, c’est une association dont le lien peut paraître assez tenu d’un premier abord avec l’éducation et, en fait, pas du tout, puisque les racines mêmes de Framasoft sont issues de l’éducation.
C’est une association de la loi de 1901, 35 bénévoles qui habitent à peu près 27 villes différentes partout en France, une équipe de neuf salariés qui sont en situation de télétravail actuellement. Née à la toute fin des années 90 dans un petit collège de Bobigny, pas très loin de ta circonscription Sabine, et qui fait partie de ta circonscription, non ?, en tout cas qui n’est pas loin. Je vais vous laisser développer un petit peu cette histoire qui peut être intéressante.
Juste pour finir, Framasoft devient une association en 2004. Pendant longtemps, elle s’est harnachée, elle a gardé une relation de proximité avec le milieu de l’Éducation nationale jusqu’à un certain nombre d’événements, notamment en novembre 2015, où le ministre de l’Éducation nationale, à l’époque c’était Najat Vallaud-Belkacem, signe un partenariat2 avec Microsoft, qui a été dénoncé devant la justice par le Collectif Edunathon. C’est vrai qu’il y a eu différents tournants dans votre rapport avec l’Éducation nationale, on vous laissera le préciser, mais en tout cas c’est peut-être à ce moment-là où le logiciel libre est un peu apparu comme une sorte de levier de pression de négociation des prix avec Microsoft plus que vraiment une véritable alternative.
Je vous laisse présenter rapidement l’origine de Framasoft et un petit peu ce que vous défendez à la fois au niveau technique mais aussi comme philosophie de société.
Pierre-Yves Gosset : Tout à fait. Déjà merci de poser toutes ces questions.
Framasoft, effectivement, est né fin des années 90, début des années 2000, dans un collège de Bobigny. Au départ, Framasoft vient d’un projet qui s’appelle FramaNet, comme français et mathématiques, pour le « fra » et le « ma », c’est-à-dire de deux enseignants, un prof de mathématiques et une prof de français qui souhaitaient mieux comprendre cet outil qu’était Internet et son impact avec son arrivée au collège et au lycée.
Sur ce site FramaNet existait une page qui s’appelait à l’époque Framasoft, qui était une page qui recensait non pas des ressources pédagogiques mais des logiciels qui pouvaient être utiles au niveau éducatif. Dans ces premiers temps on ne parlait pas du tout de logiciel libre ou très peu, je reviendrai éventuellement sur une définition de ce qu’est le logiciel libre, mais l’idée était de dire « on est enseignant, il y a cette nouvelle chose technique qui arrive au collège ou au lycée, qui s’appelle Internet, qu’est-ce qu’on peut en faire ? » Ces enseignants ont créé un site web. La partie français deviendra à terme le WebLettres3 et la partie logiciels deviendra Framasoft en 2004, lorsque les enseignants auront quitté ce collège en question.
À partir de 2004, Framasoft devient un site web, devient une communauté et devient une association. L’objet de cette association est de faire la promotion notamment du logiciel libre et de la culture libre. Je vais aller très vite parce je pense qu’on a qu’on a plein d’autres sujets à voir, mais quand on parle de logiciel libre ce n’est pas le logiciel qui est libre, c’est l’utilisateur ou l’utilisatrice du logiciel, c’est-à-dire que vous avez non seulement le droit de l’utiliser, mais vous avez le droit de le modifier, de le partager, de le redistribuer autour de vous, etc.
Donc le principe, effectivement, et, on va dire, dans l’ADN de Framasoft, on retrouve les mêmes valeurs que dans l’éducation c’est-à-dire les valeurs de partage de savoir, de partage de connaissances. L’idée à Framasoft, pendant très longtemps et encore aujourd’hui d’ailleurs, c’était d’essayer de sensibiliser le plus large public possible à cette question : est-ce qu’on peut réellement avoir une éducation libre et une société libre sans logiciel libre ? Pour nous la réponse est non, on pourrait dire que peut-être on a un regard biaisé sur la chose, mais, en tout cas, ça va forcément de pair.
Je vous passe très rapidement ce qui s’est passé dans les dix années qui ont suivi la création de l’association, mais il y a un ou deux temps que je voudrais quand même rappeler.
En 2013, ce sont les révélations d’Edward Snowden4, en juin 2013. On est une association qui est effectivement très proche du milieu enseignant, on se rend bien compte que les révélations d’Edward Snowden viennent confirmer ce que tout le monde savait depuis longtemps, qui n’était pas prouvé jusqu’à présent, c’est-à-dire qu’il y a un système de surveillance globalisée par des services de renseignement américains qui utilisent massivement les ressources de neuf entreprises à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Cisco, Yahoo et IBM, de mémoire. Grâce aux accès à ces neufs entreprises-là, la NSA peut avoir accès a à peu toutes les informations, c’est-à-dire la position GPS d’un téléphone Android, d’un ordinateur Apple, etc. Ça soulève, du coup, plein d’autres questions : en dehors même de la question de la surveillance d’État, ça pose la question de qu’est-ce qui est fait de toutes ces données qui sont collectées en permanence, ce qu’on appelle d’un point de vue très journalistique le big data, ce qui ne veut pas dire grand-chose en fait, mais ça pose cette question de où sont les données, où est-ce qu’elles vont, comment est-ce qu’elles sont utilisées.
Nous, on se rend compte à ce moment-là, on est en 2013/2014, que nous-mêmes qui sommes une association qui est issue de l’Éducation nationale qu’elle est complètement dépendante de Google. C’est-à-dire que nous, alors qu’on est plutôt pointus sur la question, on s’aperçoit que nos mails sont gérés chez Gmail, qu’on utilise des Google Groups pour échanger entre nous, etc. Donc on décide de se « dégoogliser » dans l’association. En gros, la répartition était à peu près moitié profs, un tiers d’informaticiens et le reste étant des comptables, des profs de ski , etc. On se rend compte en fait assez vite qu’on va mettre plus de six mois à se « dégoogliser », donc à sortir des services de Google pour, finalement, ne plus utiliser des services de Google, de Facebook.
Là on a une prise de conscience qui est assez tragique, on se dit que si nous on a mis six mois, combien de temps vont mettre les gens qui n’y connaissent pas grand-chose et qui ne sont pas forcément bien informés sur le sujet ? On décide fin 2014, en septembre 2014, de lancer une campagne qui s’appellera « Dégooglisons Internet5 » pendant laquelle quasiment tous les mois, pendant trois ans, on va sortir un outil libre, alternatif à ceux de Google, de Facebook ou d’autres et on s’engage à ce que ces outils soient basés exclusivement sur du logiciel libre, à ce qu’ils n’exploitent pas de données personnelles, c’est-à-dire que lorsque vous laissez votre nom, votre prénom sur des services de Framasoft on n’exploite pas ces données, elles sont enregistrées chez nous parce qu’il faut bien que vous puissiez vous identifier, aller dessus, etc., mais on ne les exploite pas tout simplement parce qu’on décide de rester une association loi 1901. On a eu beaucoup de pression de l’extérieur disant « mais ça marche tellement bien votre truc qu’il faudrait vous transformer en entreprise ». On est avant tout militants associatifs, donc on décide de ne pas devenir une entreprise, de rester une association, ce qui nous permet d’assurer et de rassurer les visiteurs et visiteuses de notre réseau de sites web qu’on n’exploitera pas leurs données tout simplement parce qu’on n’a aucun intérêt commercial à le faire et qu’on essaie, justement, de défendre un autre type de système qui ne soit pas basé sur ce qu’on appelle le capitalisme de surveillance.
On arrive, du coup, fin 2017/2018, avec une offre qui représente en gros une grosse trentaine de services en ligne, alternatifs à ceux de Google et autres. Aujourd’hui notre association reçoit – c’est forcément difficile de vous donner un chiffre précis puisqu’on ne trace pas le nombre de visiteurs précis –, mais on estime, en gros, vu le nombre de visites qu’on a mensuellement, qu’on reçoit entre 500 000 et 700 000 visiteurs et visiteuses par mois sur notre réseau, sachant que le modèle économique de notre association est basé exclusivement sur le don, c’est-à-dire que nous ne dépendons d’aucune subvention ce qui nous laisse une liberté totale de parole, on est une association a-partisane ce qui ne veut pas dire apolitique, et, du coup, on n’a pas de dépendance à une quelconque collectivité ou à un quelconque modèle de financement qui nous mettrait en soumission.
Aujourd’hui on opère cette quarantaine de services, on opère en fait au total un réseau d’une centaine de sites web différents pour, à peu près, 700 000 personnes qui viennent utiliser nos services.
On a effectivement pris un virage, sur lequel je reviendrai peut-être, en laissant de côté un peu plus l’Éducation nationale et en nous investissant beaucoup plus en tant qu’association d‘éducation populaire cette fois, notamment en ne nous limitant plus à la question du logiciel libre mais en l’élargissant, finalement, à celle des enjeux du numérique. Donc aujourd’hui Framasoft est une association d’éducation populaire aux enjeux du numérique et ce depuis 2015 où on a vraiment pris de virage-là.
Alexandre Schon : Merci.
Juste pour terminer ce petit développement, un mot aussi Pierre-Yves Gosset sur la décision que vous avez prise en 2019, en septembre 2019, de réduire un certain nombre d’applicatifs, de services sur les 30/40 que vous avez faits. Ça s’inscrit dans cette démarche non pas de « dégoogliser » mais de décentraliser aussi l’Internet pour ne pas se transformer en fournisseur de services libres. J’ai notamment lu un billet très intéressant que vous aviez émis sur un autre mot que j’ai trouvé très intéressant, Contributopia6. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix de réduire un peu le faisceau de services que vous mettiez à disposition des utilisateurs ?
Pierre-Yves Gosset : La réponse est assez simple, c’est que ce qu’on dénonce c’est aussi la centralisation des données. À partir du moment où on reçoit 700 000 personnes par mois sur nos services, très honnêtement on aurait pu passer à 2 millions, 5 millions. Là typiquement, lorsqu’on est passé en période de confinement, on aurait pu accueillir probablement le double, le triple, le quadruple de personnes en investissant dans les serveurs, en recrutant des personnes, mais on défend un autre type de modèle de société. En fait, pour simplifier, vous pouvez considérer Framasoft comme une AMAP du numérique. Les AMAP sont des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne où, normalement, on met en relation des citoyens/des citoyennes, des agriculteurs/agricultrices de façon à ce qu’ils se mettent ensemble pour partager les fruits, les légumes et partager l’argent de façon à ce que l’agriculteur ou l’agricultrice puisse anticiper un petit peu les commandes dans l’année ; ça crée un rapport qui est complètement différent entre ce qu’on mange, comment est-ce qu’on le mange, qui l’a produit, dans quelles conditions, etc. Framasoft est exactement sur ce modèle-là, c’est-à-dire qu’on estimait qu’on avait atteint la taille maximum que l’on devait atteindre – on pourrait croître – on a fait le choix d’arrêter notre croissance ; tout va bien. Concrètement on est association qui aujourd’hui souffre assez peu, en tout cas financièrement, de la pandémie, alors qu’en tant que militants associatifs on voit toutes les autres associations qui vont durement souffrir, à mon avis, dans les mois qui viennent. Du coup, on se rend bien compte qu’il y a une logique à faire de la proximité et, finalement, on se considère comme une grosse AMAP, mais on a préféré essaimer notre démarche plutôt que de croître de façon verticale. On a préféré essaimer de façon plutôt horizontale, donc on a impulsé, fin 2016, un collectif qui s’appelle CHATONS, parce qu’évidemment quand on fait un peu d’informatique on aime bien rigoler sur les chatons sur Internet et CHATONS7 signifie Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts Neutres et Solidaires.
Aujourd’hui ce collectif compte en gros 70 structures qui peuvent être des particuliers, des petites entreprises, etc., qui, elles aussi, s’engagent un peu sur le modèle de ce que fait Framasoft, finalement à accueillir des citoyens et citoyennes qui ont des besoins en services informatiques sans exploiter les données. C’est encore une fois le principe de l’AMAP : vous allez pouvoir rencontrer le chaton proche de chez vous qui est souvent un informaticien ou une informaticienne, ils peuvent être plusieurs, ça peut être un petit collectif. Pour nous, cette notion-là est extrêmement importante, je pense que j’y reviendrai plus tard, mais c’est vraiment de refaire du lien parce que sur ces questions du numérique on a été ce que Bernard Stiegler appelle prolétarisés, c’est-à-dire qu’on a perdu la connaissance de savoir ce qu’était le numérique, de savoir comment ça fonctionnait. On a perdu, finalement, notre outil de production et on est juste devenus des consommateurs.
À partir du moment où on se rapproche de quelqu’un qui va opérer, je ne sais pas, un service e-mail, qui ne soit pas Gmail mais qui soit chatonmail, un petit hébergeur local par exemple associatif, eh bien quand le mail est en panne la personne peut vous dire « le mail était en panne parce qu’il y a eu tel problème sur la machine et, du coup, je devais m’occuper de mon enfant et je n’ai pas pu réparer ce soir-là donc les mails sont revenus le lendemain.
Expliquer ça, effectivement, c’est complètement basculer de système et c’est se rendre compte, finalement, que l’informatique ce n’est pas de la magie et on voit bien, notamment dans le débat autour de Stop-Covid, qu’on est vraiment dans ce qu’on appelle du solutionnisme technologique, c’est-à-dire une application magique qui va venir arrêter un virus. Or une technologie n’a jamais arrêté le moindre virus, ça n’est jamais arrivé et ça n’arrivera jamais puisque ce sont des technologies numériques, ça n’arrête pas des virus biologiques ! Il faut des hommes et des femmes pour ça.
Du coup, quand on a pris un petit peu conscience de ça, on s’est dit qu’on allait arrêter la campagne Dégooglisons Internet qui marchait très bien, encore une fois, on est des spécialistes pour se tirer des balles dans le pied mais volontairement, parce qu’on est effectivement persuadés qu’il faut amener autre chose et ce qu’on a essayé d’amener c’est un autre modèle de société. Donc on a créé un mot-valise entre la question de la contribution et la question de l’utopie, puisque utopie ne signifie pas quelque chose qui n’arrive pas, ça signifie quelque chose qui n’existe en aucun lieu. On trouvait que ça correspondait assez bien à la définition d’Internet.
Alexandre Schon : Merci.
On reviendra sur la vision politique de tout ça. Juste en deux trois petites phrases pour bien repréciser aux gens qui nous écoutent, quelles sont les différences fondamentales et un exemple concret, mais très rapide si ça vous est possible, entre ce qui relève du logiciel libre et des solutions qu’on appelle des solutions propriétaires, comme Google, Microsoft, Facebook, etc. ? Concrètement ça change quoi dans ma vie d’utiliser Framapad au lieu de Google Drive par
exemple ?
Pierre-Yves Gosset : Eh bien vous êtes libre ! Lorsque vous utilisez Google Docs, c’est Google qui va décider où sont stockées vos données. C’est Google qui va décider où s’affiche tel ou tel bouton ; c’est Google qui va décider si c’est gratuit ou pas ; c’est Google qui va décider s’il y a de la publicité ou pas ; c’est Google qui va décider, finalement, de l’ensemble du fonctionnement du système ; c’est lui qui vous le propose, il vous y donne accès le plus souvent gratuitement, donc vous l’utilisez et point barre. Vous êtes utilisateur-consommateur.
La différence avec le logiciel libre, c’est qu’avec le service, est fournie la recette de cuisine de ce logiciel, ce qu’on appelle le code source, donc le principe c’est qu’en vous fournissant finalement la recette de cuisine du logiciel, vous allez pouvoir l’adapter à vos besoins ; vous allez me dire je ne suis pas informaticien ou informaticienne, je ne sais pas comment modifier tel ou tel logiciel. Oui, mais il y a des gens qui savent le faire. Et le fait d’avoir la possibilité de le faire remet de la transparence et remet de la confiance dans l’ensemble du système. Si je prends un cadre plus élevé, les comptes de la nation sont publiés chaque année, on peut savoir combien coûte tel ou tel rond-point. Moi, personnellement, ça ne m’intéresse pas forcément, mais le fait de savoir qu’est publié le prix et le coût de tel ou tel rond-point est quelque chose qui me donne confiance, normalement, dans la façon dont est géré l’argent public.
Alexandre Schon : Je comprends et ça fait écho à beaucoup d’auditions que nous avons faites sur la nécessité et la soif de la société dans la confiance. Il y a besoin de reconstituer cette confiance dans tous les pans de la société et notamment dans le numérique sur le code source qui soit auditable aussi, que ce ne soit pas noyé dans une impossibilité technique d’auditer ce code source, de voir s’il est bien transparent, etc., de voir quelles données rentrent dans le système et sont passées à la moulinette, etc. Vous, vous essayez à votre niveau, à l’échelle non pas simplement d'une relation de consommateur, mais dans une relation de coopération, de coconstruction avec les utilisateurs qui sont aussi les artisans de leurs propres solutions, de reconnecter l’outil numérique dans une relation de confiance.
Pierre-Yves Gosset : C’est exactement ça. On essaye de faire des communs, finalement, à partir du logiciel.
Alexandre Schon : On repartira sur une définition du commun informationnel un petit peu plus tard. On va rentrer vraiment dans des questions plus précises et plus concrètes maintenant.
Question tout à fait concrète, Pierre-Yves Gosset, comment est-ce que vous avez vécu et comment est-ce que vous avez pu pallier progressivement à la saturation des services Framasoft depuis le début des politiques de confinement en Europe ? Vous avez subi de plein fouet d’abord, avant même la vague française, les vagues espagnole et italienne sur vos services. Je sais que vous avez fait un mémo pour le télétravail libre, vous avez fait plusieurs éléments. C’est une association dont les services sont des ressources communes qui peuvent être utilisées par des personnes qui parfois n’ont pas d’autre moyen, comme des malades isolés dans leur famille, donc il y a aussi l’idée de ménager cette ressource afin qu’elle reste partagée. Vous avez dû faire un travail d’optimisation logicielle, de redimensionnement des infrastructures techniques, de répartition des demandes parmi un ensemble d’hébergeurs éthiques et solidaires. Concrètement, comment est-ce qu’au quotidien neuf salariés et 35 bénévoles ont pu faire face à une telle vague d’abord espagnole et italienne puis française ?
Pierre-Yves Gosset : On n’a pas bien fait face, je pense comme tout le monde. Il y a eu une phase de sidération. J’ai envie de dire qu'on avait deux avantages. Le premier c’est que l’équipe salariée de Framasoft travaille essentiellement en télétravail depuis toujours, donc on était habitués, finalement, à pouvoir travailler de chez soi avec uniquement une connexion internet, puisque les salariés de Framasoft sont à Lyon, en Ariège, à Toulouse, à Nancy, à Nantes, en Picardie, on est répartis sur le territoire, donc on n’a pas eu la phase de « il va falloir bouger son outil de travail et réadapter ses méthodes de travail au confinement et au télétravail. » C’était le premier avantage, c’est-à-dire que le lendemain de l’annonce du confinement on était opérationnels le matin comme à peu près n’importe quel jour.
La différence, effectivement, c’est que quand différents pays se sont confinés, notamment l’Italie et l’Espagne, ils ont eu le même problème qu’a eu la France quelques jours plus tard, c’est-à-dire qu’une grosse partie de la population s’est retrouvée à devoir faire du télétravail, à devoir faire de la visioconférence, à devoir travailler sur des documents collaboratifs, etc., et elle ne savait pas où aller.
Si je prends le cas spécifique de l’Éducation, typiquement, en tout cas en France, les enseignants et les élèves étaient invités à aller sur les ENT, effectivement si on y revient, je ne vais pas développer maintenant, mais en gros ça n’a pas fonctionné dans les premiers jours. Il y a une petite partie de 12 millions d’élèves et 800 000 enseignants qui connaissaient Framasoft parce que, historiquement comme je l’ai expliqué en introduction, on est proches du milieu enseignant, forcément ils se sont dit « on va aller utiliser les services de Framasoft ». Notre réaction a été un petit peu dure pour ce milieu historique, sachant que, encore aujourd’hui, il y a pas mal d’enseignants dans l’association Framasoft, on ne les a pas empêchés de rentrer sur nos services, mais on a mis un gros bandeau expliquant « si vous êtes enseignant ou enseignante, eh bien vous êtes gentil, mais vous allez voir votre ministère de tutelle et vous lui dites qu’en tant que service public il doit fournir un service pour vous, puisque c’est son rôle, et que ça n’est pas à une association de supporter, finalement, les défaillances d’un service public. » Encore une fois, on aurait pu faire un tout autre choix et dire « tous les enseignants de France et de Navarre sont les bienvenus chez nous », peut-être qu’on aurait ou multiplier le nombre de services assez rapidement, etc. Si je prends la visioconférence, quasiment du jour lendemain on a fait X 8 fois, X 10 en nombre de visioconférences, on est passé à 1600 conférences par jour en quelques heures et il a fallu assumer ça.
Donc on ne l’a pas forcément bien vécu et, toujours vis-à-vis de l’Éducation nationale, on a trouvé un petit peu difficile de dire aux enseignants qu’ils devaient assurer la continuité pédagogique, c’est un terme qui nous a paru assez dur, puisqu’ils n’étaient pas prêts. Clairement, pour moi, le ministre a menti en disant « on est prêt, nos services sont prêts, les enseignants sont prêts. » Non ! Ils ne l’étaient absolument pas, ils ont fait du mieux qu’ils ont pu et c’est déjà formidable. Ce qui paraissait le plus important pour nous, c’était comment est-ce qu’on peut continuer à opérer nos services, y compris pour les gens qui ne viennent pas du milieu de l’éducation, c’est-à-dire des collectifs, des syndicats et autres.
Alexandre Schon : Donc votre choix ça a été de dire si on accueille l’Éducation nationale maintenant, on ne pourra plus faire face pour ceux qui sont encore plus dans le besoin qu’eux. En même temps on fait le choix, pas de sacrifier, mais de mettre un peu de côté les enseignants parce qu’ils sont censés avoir des solutions de leur propre ministère, donc il faut, limite, se retourner vers le ministère pour trouver les solutions adéquates, nous ce n’est pas notre rôle.
Pierre-Yves Gosset : Je vais prendre une métaphore assez dure sans doute, mais c’est un petit peu comme si on avait dit à tous les élèves, du jour au lendemain, d’aller non plus à la cantine mais d’aller aux Restos du cœur. Je ne dis pas qu’on est les Restos du cœur, on ne sauve pas à des gens de la faim, mais, à un moment donné, c’est un peu ce type de service qu’on essaye de rendre, c’est-à-dire un service qui permet de démontrer qu’il est possible de faire autrement, notamment pour les personnes qui n’ont pas les moyens de se payer des licences Google, Microsoft, etc. Du coup, si les Restos du cœur passaient de 10 000 repas par jour à 1 million de repas par jour, ça ne marcherait pas et ça n’est pas leur rôle, en tant qu’association, de nourrir les élèves qui sont, eux, dans un service public.
Alexandre Schon : Vu qu’on est rentré carrément dans le sujet éducation, je reviendrai après deux secondes sur le confinement, comment vous avez dû faire face au confinement de façon tout public. Là on est rentré dans la thématique éducation donc autant y aller à fond.
Rapidement, ce qui m’a beaucoup interpellé avant de vous démarcher, de vous proposer de vous inviter avec Sabine, c’est effectivement ce bandeau que vous avez mis. Je suis un utilisateur très régulier des solutions Framasoft, c’est la première fois que j’ai vu ce bandeau et je l’ai vu en situation d’enseignant. Je me suis senti un petit peu comme un réfugié climatique et, en même temps, j’ai tout à fait compris votre position. Je lis rapidement le bandeau parce que je l’ai gardé en copie pour montrer et c’est aussi une façon d’interpeller les acteurs publics : « C’est un crève-cœur de demander ça malgré le lien très fort que nous avons avec les enseignants. Nous avons aussi une longue histoire de désaccord avec le ministère, notamment au sujet de Microsoft. On sait qu’il y a des talents dans l’Éducation nationale, mais il n’y a pas de volonté et de vision politique pour équiper de manière sereine le personnel et leurs élèves avec des logiciels libres. Ce n’est pas à nous de pallier les carences du ministère ». Ce n’était pas exactement ce bandeau-là mais c’était une des déclarations. Vous avez dit : « Si vous êtes élève ou professionnel de l’Éducation nationale, dans la mesure du possible, n’utilisez pas notre service ». C’est la première fois que vous devez demander un truc comme ça, donc c’est un choix terrible de votre part mais, en même temps, j’en suis totalement convaincu, un vrai crève-cœur.
Du coup, on va juste rentrer très rapidement dans le domaine vraiment de l’éducation. Il y a plus de 12 millions d’élèves qui sont en situation de confinement en France comme vous l’avez dit. Il y a pratiquement un million de personnels, qu’ils soient administratifs ou de direction, eux aussi en situation de confinement et de télétravail. Le ministère devait faire face à plus de sept millions de connexions journalières sur ses services. Il y a visiblement eu un certain nombre de problèmes au début, de ce que j’ai cru comprendre. Comment vous expliquez ces problématiques que le ministère de l’Éducation nationale a rencontrées pour offrir à son personnel un service qui soit tout de suite réactif ? Comment vous expliquez ?
Pierre-Yves Gosset : La réponse est assez simple. On parle souvent d’autoroutes de l’information quand on parle d’Internet et c’est vrai que la métaphore tient assez bien. Moi je préfère celle de la plomberie mais retenons celle des autoroutes, c’est assez vrai. Internet, si ce sont des autoroutes, si vous dites du jour au lendemain à 12 millions d’élèves rendez-vous tous Place Bellecour à Lyon lundi matin, vous anticipez que ça ne va pas marcher ; c’est pas possible ! Vous envoyez des voitures, des cars, des bus, etc., 12 millions de personnes au même endroit, c’est-à-dire des élèves sur les ENT [Espaces numériques de travail] des différentes académies, juste ça ne pouvait pas fonctionner !
Je ne connais absolument pas Jean-Michel Blanquer et ses compétences, mais je ne pense pas qu’il soit si mal entouré que ça, que personne ne lui ait dit la veille « non, mais en fait ça ne va pas fonctionner ». C’était une évidence ! Il n’y a pas un informaticien qui vous dira « oui, oui, bien sûr, du jour au lendemain, vos Espaces numériques de travail vont pouvoir multiplier par 100 leur charge. Les ENT étaient utilisés mais quelques fois par jour, voire quelques fois par semaine par les enseignants et par les élèves. À partir du moment où ils deviennent utilisés huit heures par jour par 12 millions d’élèves et 800 000 profs, c’était une évidence que ça n’allait pas fonctionner.
Ça c’est pour répondre à la question pourquoi, finalement, ça ne fonctionne pas ? Juste parce qu’on a redirigé des millions de personnes dessus du jour au lendemain.
La réponse qui pouvait être apportée, elle était soit de tout basculer chez des services notamment américains, étasuniens, qui sont capables, eux, de monter en capacité quasiment sans limites avec évidemment une question de coût qui peut être très importante.
Alexandre Schon : Ils l’ont prouvé d’ailleurs.
Pierre-Yves Gosset : Tout à fait. Effectivement, on voit bien que du jour au lendemain il y a des millions de personnes sur la planète, des centaines de millions de personnes sur la planète qui se sont mises à utiliser massivement Google, Facebook, etc., de façon plus intensive et on n’a pas eu de panne de Facebook, on n’a pas eu de panne de Google. Donc il y a un moment donné où il faut reconnaître à ces entreprises-là une capacité technique qui est extrêmement forte. Le plus gros hébergeur mondial aujourd’hui c’est Amazon. Tout le monde parle d’Amazon, la boutique en ligne, mais, en fait, ils ont un business d’hébergement de données et d’hébergement de trafic internet qui est extrêmement fort ; Netflix passe, utilise les services d’Amazon.
On est sur des entreprises qui, elles, pouvaient accueillir ce volume-là et, pour des raisons heureusement logiques sur lesquelles on pourra revenir, l’Éducation nationale n’avait pas fait le choix d’aller s’héberger en masse chez Amazon ce qui aurait coûté, en plus, un coût absolument monstrueux à partir du moment où ils auraient multiplié par 100, ça sortait du contrat ça aurait coûté très cher.
L’autre solution qui est celle que nous préconisons, c’est qu’on refasse du local, c’est-à-dire que les services, les ENT et autres, soient finalement, en termes de proximité, au plus proche des académies, des élèves et autres. Typiquement, je ne vais pas aller dire jusqu’à chaque lycée, mais si chaque groupe d’établissements avait son service informatique avec ses services de visio, etc., qu’il pouvait activer à la demande, on n’aurait pas eu ce problème-là. Donc on en revient à une logique qui est celle de l’origine d’Internet, qui est d’être décentralisé et d’être résilient. On a construit d’énormes points de données, des espèces de bretelles d’échange d’autoroutes, elles ont été forcément complètement saturées dans les premiers jours.
Alexandre Schon : Du coup, pour faire une comparaison avec un sujet que les gens qui nous écoutent maîtrisent peut-être davantage, c’est comme si vous prôniez un retour au consommer local, c’est à-dire je vais voir mon agriculteur local, etc., donc j'héberge aussi mes données en local et j’évite de les externaliser par rapport à mon écosystème numérique proche. C'est ça ?
Pierre-Yves Gosset : C’est ça. L’idée est double, elle est à la fois de faire du local et du maîtrisé, c’est-à-dire qu’un des gros soucis – je reviens là-dessus, ça rebascule un peu sur la partie politique – c’est que si on veut maîtriser l’informatique, si on veut se déprolétariser, il va falloir, à un moment donné, reprendre la maîtrise de l’outil informatique ; si on veut se réapproprier ça, eh bien il faut remettre les mains dedans. Exactement comme, si vous voulez faire pousser des carottes, eh bien, à un moment donné, il faut aller dans la terre, il faut planter, etc. On peut aller au supermarché, je ne suis pas choqué par l’idée que des personnes utilisent des logiciels propriétaires, si c’est leur choix et que c’est fait de façon éclairée, je n’ai pas forcément de problèmes avec ça. La difficulté c’est que, pour filer la métaphore, on a habitué les gens à aller au supermarché et ils ne savent plus comment pousse une carotte, ils ne savent plus comment pousse une tomate et, du coup, ils ne comprennent plus rien et quand, du jour au lendemain, on leur dit « les légumes c’est terminé », ils n’ont plus rien à manger. C’est plus ou moins le type de situation auquel on a dû faire face lors du confinement, c‘est que les gens se sont rabattus sur les solutions qu’ils connaissaient, à savoir celle de Google, de Microsoft ou, pour la visio celle de Zoom, la preuve ici, sans se poser la question de savoir comment ça fonctionnait, qui allait l’utiliser, où partaient les données, etc.
Donc nous, effectivement, on est pour une décentralisation des services mais surtout, si le numérique est quelque d’important, vous devez comprendre comment ça marche. Donc là ça pose une question plus large de l’éducation aux médias, de l’esprit critique face au numérique, etc.
Alexandre Schon : Super, l’allusion à la carotte et tout, c’est super compréhensible, c’est génial.
Sabine Rubin : Excusez-moi, ce n’est pas compréhensible pour tout le monde parce que, si j’imagine bien ce que ça veut dire planter une carotte sans même savoir en planter une, j’ai beaucoup plus de mal ! Justement, pour quelqu’un de complètement novice comme moi, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça signifierait ?
Pierre-Yves Gosset : Oui, tout à fait, vous avez complètement raison. Personnellement je suis nul en jardinage, je n’ai pas la main verte, mais je sais que je peux apprendre, j’ai cette possibilité-là. Ce qui m’intéresse, à un moment donné, c’est qu’on puisse redonner ces savoirs aux personnes. Je me doute bien que vous n’allez pas vous transformer du jour au lendemain en informaticienne qui va être capable d’installer un serveur en ligne et de taper des lignes de commande que vous ne comprenez pas nécessairement, par contre vous pouvez vous rapprocher de gens qui, eux, sont intéressés à faire ça et à proposer ce type de chose.
Donc le fait d’avoir accès à ces connaissances, le fait de pouvoir demander de l‘aide et le fait de pouvoir faire ensemble, donc de pouvoir dire « moi je ne sais pas du tout planter des carottes, par contre j’ai des tomates dans mon jardin, est-ce que ça te dit qu’on échange, etc. ? » Pour moi, on peut faire la même chose avec l’informatique. On a mis l’informatique, on a transformé l’informatique comme si c’était une solution technique neutre et gérée par des grandes entreprises, etc. Or, quand je disais qu’Internet c’est de la tuyauterie, je vous assure que si vous saviez faire de la plomberie, vous sauriez faire de l’Internet et ce n’est pas beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment, ça touche à des technologies numériques qui ont tendance à faire peur parce qu’on vous a dit que vous n’aviez pas à vous en occuper. Si vous ne savez pas changer un tuyau, si votre siphon fuit, etc., vous pouvez appeler un réparateur, ça ne pose pas de problème, le plus souvent c’est artisan du coin, ce n’est pas quelqu’un qui vient des États-Unis pour vous changer votre lavabo. En informatique, amener Internet ou brancher un réseau internet, c’est tirer des câbles, c’est les raccorder, etc. Et le flux d’informations rappelle relativement le flot de l’eau qui nous arrive dans nos maisons.
Ne plus maîtriser ça, c’est nous mettre dans une situation de dépendance et c’est finalement nous mettre dans une situation où on n’a plus de capacités à choisir quelles vont être les orientations du numérique demain. Et c’est ça qui nous inquiète particulièrement, c’est-à-dire que pour les enseignants, c’est bien beau qu’ils aient maintenant accès à du Zoom, à du Google Classroom, etc., qui ne sont normalement pas autorisés en classe, mais ce qui me pose question c’est, à un moment donné, est-ce que ce sont vraiment les meilleurs outils pour la classe ? Et du coup, si ce ne sont pas les meilleurs outils peut-être que les enseignants auraient leur mot à dire pour savoir comment il faudrait produire ces outils. Oui, mais s’ils n’ont plus accès aux savoirs pour produire ces choses-là ! Et je vous assure que dans l’Éducation nationale il y a des milliers de profs qui s’y connaissent plutôt bien voire plutôt très bien en informatique et je ne parle même pas des personnels techniques de l’Éducation nationale qui sont, pour certains, parmi les meilleurs que je connaisse et qui, du coup, pourraient coconstruire ces solutions-là avec les enseignants. Mais on est resté dans une solution où on va consommer la carotte plutôt qu’apprendre à la planter.
Alexandre Schon : Donc on est dans une relation qui est descendante et non pas dans une relation horizontale où on communique entre personnes, dans une forme un petit peu d’économie circulaire d’une certaine manière. On est dans cette dépendance et, comme vous le disiez, Pierre-Yves Gosset, c’est un choix éminemment politique qui est un choix de reprendre le contrôle du numérique qui n’est pas un outil, qui n’est pas quelque chose qui n’est fait que pour les techniciens, mais qui est aussi fait pour les citoyens, pour les habitants, qui vont eux-mêmes choisir le virage que va prendre le numérique demain, en termes de virage éthique, en termes de virage politique et de la façon dont on veut que le numérique soit demain. Et non pas le numérique qui est laissé en proie aux GAFAM et aux grandes multinationales, notamment aux grandes sociétés, par exemple aux opérateurs en charge de la surveillance de masse, on y reviendra à la fin de l’échange.
Juste une dernière précision, Pierre-Yves Gosset, avant que je pose une autre question, peut-être une réponse un peu rapide si ça vous est possible, quelle est la part des solutions dites propriétaires ou, en tout cas, des solutions privées dans le système éducatif français aujourd’hui ? Et peut-être, si jamais vous le savez, dans les systèmes éducatifs européens aujourd’hui ?
Pierre-Yves Gosset : C’est très variable et c’est difficilement chiffrable parce que c’est variable suivant les académies en plus, au niveau français et, en Europe, il y a des situations extrêmement variables. En Espagne, il y a pas mal de solutions libres qui existent, en France aussi, qui peuvent être mises en place. Ce qui est sûr c’est que les solutions propriétaires sont majoritaires, les solutions libres existent. Il y a ce qu’on appelle les DANE, les Délégations académiques au numérique éducatif, qui, dans certaines académies, peuvent parfois faire le choix de déployer des solutions libres dans leur académie alors que d’autres vont faire d’autres choix.
Ce qui est sûr c’est qu’il n’y a pas, à ma connaissance, une préconisation du ministère, de l’administration centrale qui dirait qu’il faut privilégier les solutions libres. La raison en est assez simple c’est que, là du coup c’est un avis j’allais dire très personnel mais qui a été constaté, quand même, il y a une forme, et je n’ai pas envie d’employer le mot corruption, mais en tout cas de lobbying particulièrement fort des GAFAM. Je rappelle que Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft font partie des cinq ou six plus grosses capitalisations boursières mondiales, ils ont donc des moyens pour investir les ministères, aller rencontrer les ministres, les directeurs de cabinet, etc. Je ne dis pas du tout qu’ils font des pots-de-vin, par contre on a vu des situations comme en 2015, vous l’évoquiez en tout début de l’entretien, quand Najat Vallaud-Belkacem signe le partenariat avec Microsoft, je crois que c’est son directeur de cabinet qui est à côté d’elle sur la photo, aujourd’hui il travaille chez Amazon. C’est une technique assez ancienne qu'on appelle le pantouflage, revolving doors, qui permet, à un moment donné, de dire « OK, je te donne ce marché et tu m’embauches quand la situation politique a évolué ». Il s’est passé la même chose dans l’Éducation nationale que dans plein d’autres ministères. Donc la situation du Libre, aujourd’hui, ne peut pas lutter face à ces entreprises qui disposent de milliards de dollars ; je rappelle qu’Apple c’est plus de 100 milliards de dollars qu’ils ont sur le compte en banque, donc « en liquide » entre guillemets, disponible en trésorerie sur le compte en banque, c’est une entreprise qui pèse plus que de mille milliards de dollars. Le logiciel libre, lui, est fait essentiellement par des communautés ou des petites entreprises, nous n’avons pas les moyens économiques et nous ne le souhaitons pas d’ailleurs, mais nous n’avons pas cette force de frappe, de marketing, de démarchage, de machin, etc., qui permettrait d’aller convaincre des gens qui se diraient, après tout, l’outil est neutre. Pour moi, le premier pas c’est de bien faire comprendre aux responsables politiques qu’un outil neutre ça n’existe pas, que ça soit un marteau, que ça soit un logiciel, que ça soit un avion, tout est politique. Donc le logiciel libre l’est autant que le logiciel propriétaire, donc quand on fait le choix de ne pas mettre en avant, de ne pas favoriser le logiciel libre ou de ne pas préconiser le logiciel libre comme solution à privilégier au sein de l’Éducation nationale, on fait un choix politique.
Alexandre Schon : Très bien. Écoutez, c’est on ne peut plus clair.
Je vais avancer un petit peu. Finalement, pour prendre un petit peu de recul : quelle est, selon vous, la place que doit occuper le Libre et la place plus généralement du numérique dans les systèmes éducatifs contemporains. Ça c’est ma première question.
Deuxième question, dans l’hypothèse du monde d’après : quelle place pour l’éducation et la sensibilisation au Libre et à la préservation des données personnelles auprès des élèves dans les parcours d’éducation et de formation de ces derniers et aussi des adultes. Vous l’aviez abordée tout à l’heure, la question de la pédagogie autour de ces outils, être sensibilisé au Libre, à l’ouvert et aux communs, à la fois pour les élèves et aussi pour les adultes.
Donc il y a deux questions : la place du Libre en général dans le système éducatif et la question de l’éducation et de la sensibilisation au Libre pour les élèves, les personnels et les adultes.
Pierre-Yves Gosset : Sur la première question, la place du Libre dans l’éducation, nous on pense qu’elle doit être aussi forte que possible, c’est-à-dire que parfois on ne trouve pas, pour certains besoins, des logiciels libres existants. Dans ce cadre-là, si vous voulez utiliser ou acheter un logiciel propriétaire entre guillemets « pourquoi pas ». Par contre, ça nous paraîtrait intéressant de se poser la question : est-ce qu’on ne pourrait pas développer un logiciel libre équivalent qui permettrait répondre à ce besoin-là, de façon à ne pas retomber dans une situation de dépendance.
Plus largement, encore une fois dans l’Éducation c’est d’autant plus critique qu’une fois que vous avez eu un élève qui a commencé par exemple, on va dire à 12 ans, à utiliser Microsoft Word, qui va l’utiliser jusqu’à la fin du lycée, puis qui va l’utiliser à l’université à côté de Excel et d’autres logiciels, quand il va aller en entreprise ou en association d’ailleurs – il n’y a pas que l’entreprise comme débouché d’emploi, le travail n’est pas nécessairement un objectif de vie – la problématique que ça va poser derrière c’est que forcément il va maîtriser cet outil-là, il va se sentir à l’aise avec Word et Excel, il ne va pas se dire « je vais essayer autre chose » et ce sera relativement logique. C’est une analogie pas très sympathique mais qu’on a longtemps utilisée, je l’utilise moins maintenant parce que je trouve qu’elle est un peu tendue, c’est de dire que la première dose de drogue est gratuite. Tout l’intérêt de Microsoft, d’Apple, de Google ou bientôt de Facebook, va être de dire « à l’école on vous offre la première dose gratuitement », comme ça les élèves qui sont formés avec du Word et de l'Excel, quand ils deviendront plus tard des professionnels dans leur métier et qu’ils vont devoir utiliser le numérique, c’est vers ces solutions-là qu’ils vont se tourner. Ça c’est le premier aspect.
Sur le deuxième aspect du numérique, je pense qu’il n’en faut pas trop à l’école, pourtant je suis plutôt technophile, du coup, soyons clairs, là aussi ce sont des choix politiques à décider. Si ce qu’on retire comme expérience de cette période de pandémie c'est que, après tout, un prof peut bien faire cours en ligne à 30 élèves, eh bien pourquoi pas à 300 et pourquoi pas à 3000 ? À ce moment-là ne se posera plus la question de savoir s’il suffit d’être en visio pour faire son cours et après on appuie sur « déconnecter » et on peut passer à autre chose, autant regarder des vidéos sur Internet et, du coup, on n’est plus dans de l’éducation, on est dans de l’information de masse et on n’est plus dans un rapport personnalisé avec les élèves. Il y a plein d’enseignants qui, dans cette période pourtant extrêmement difficile, ont fait de leur mieux pour maintenir ce rapport personnalisé avec des outils numériques, mais je ne connais pas d’enseignant, et pourtant on a discuté avec pas mal de profs ces derniers temps, qui m’ait dit « je préfère utiliser le numérique pour suivre mes élèves, parce que j’arrive mieux à les suivre avec du numérique qu’à les rencontrer en face à face et à les voir régulièrement. »
Donc la place du numérique doit rester raisonnable. Le numérique est outil qui peut être formidable pour des personnes qui se retrouveraient éloignées, pour des personnes qui sont malades, qui ont des handicaps, ça peut être super surtout pour apprendre des façons de coopérer, il y a de très bonnes coopérations qui vont pouvoir passer par le numérique, mais on en revient à un débat qui est vieux comme l’école : est-ce qu’on forme des citoyens ou est-ce qu’on leur apprend à remplir leur feuille d’impôts. Du coup, est-ce que les savoirs doivent être extrêmement ciblés ou, au contraire, est-ce qu’on est sur la formation de l’esprit critique. Le numérique est un outil parmi d’autres mais, pour nous, alors qu’on est plutôt technophiles, il y a vrai danger derrière à faire du solutionnisme technologique et à mettre le numérique sur un piédestal en disant « finalement ce n’est pas grave, tu n’as qu’à m’envoyer ton document par WhatsApp ou par machin », des solutions qui, en plus, sont relativement dangereuses d’un point de vue vie privée et qui transforment l’enseignant en une espèce de pieuvre multitâche, capable de se débrouiller avec le numérique, avec la psychologie de l’enfant, avec les savoirs, avec la transmission du savoir, etc.
Le numérique doit avoir une place, mais elle ne doit pas déborder du cadre de ce que les enseignants choisissent parce que, au final, ce sont eux qui se retrouvent face aux élèves.
Alexandre Schon : Ma dernière question concernant le numérique – peut-être que Sabine en aurait à poser – c’est : est-ce que vous comprenez que des professeurs aient dû avoir recours à des solutions privées comme Discord, WhatsApp, pour pouvoir fonctionner plus efficacement et maintenir le contact avec certains élèves ? Quels risques comporte le fait de faire cours sur de telles plateformes privées, ne serait-ce que sur la propriété des cours qui sont postés dessus, etc. ? Est-ce que vous comprenez ce choix ?
Pierre-Yves Gosset : Oui, tout à fait, je le comprends. J’ai cette image qui peut être fausse, je sais, et, encore une fois, l’Éducation nationale c’est 12 millions d’élèves et 800 000 profs, on ne peut pas avoir une vision totalement homogène et mettre toutes les situations dans la même vision. J’ai quand même cette vision de personnes qu’on aurait abandonnées sur l’autoroute en disant « maintenant c’est le confinement, débrouillez-vous avec vos élèves ». J’avais lu une interview de Jean-Michel Blanquer, absolument hallucinante, qui disait : « Oui, on a peut-être perdu entre 6 et 10 % des élèves, qu’on n’arrive pas à joindre ni par téléphone ni par d’autres moyens, etc. ». 6 à 10 % ! Je trouve la situation absolument hallucinante et il y a eu clairement défaillance.
Comprendre que les enseignants se soient tournés vers des solutions propriétaires, je le comprends totalement, ils ont fait de leur mieux. On les a mis dans une situation de stress absolument phénoménale, ils se sont tournés vers les outils qu’ils ont pu utiliser et OK. Donc je ne porte pas de jugement, mais il faut quand même apporter un éclairage sur les modèles de ces entreprises. Que ça soit Google, Facebook ou Zoom, ce ne sont clairement pas des philanthropes. On est d’accord que Zoom c’est une startup, elle lève des fonds de donateurs essentiellement privés ou de fonds d’investissement. Le principe, derrière, c’est que ces gens-là rentrent dans leurs frais ; quand ils donnent, la dernière levée de fonds de Zoom, était à plusieurs millions de dollars, j’avais regardé, quand ils lèvent 24 millions de dollars, il va bien falloir les rembourser à un moment donné ou à un autre. Ils ne vont pas proposer leurs services gratuitement juste en échange d’une petite publicité ou autre ; à un moment donné, ils vont rentrer dans un bras de fer. Leur objectif c’est d’être la solution la plus répandue de façon à avoir le plus large marché, avoir rendu les gens dépendants à leur solution et, une fois que c’est fait, vous pouvez faire avaler à peu près n’importe quoi aux utilisateurs et utilisatrices.
Donc oui, il y a clairement un risque d’appropriation des données. Concernant Facebook et Google il y a un risque d’accroissement de ce qu’on appelle le graphe social, c’est-à-dire que « grâce » à tout ça, « grâce » à la pandémie, je mets évidemment beaucoup guillemets autour de « grâce », mais avec la pandémie les enseignants se sont tournés vers Google Classroom et Google peut savoir quels sont les établissements qui ont ouvert des comptes, quels sont les types de cours qui sont faits dessus, comment c’est utilisé, etc., donc à la fois acheminer leurs produits et préparer des futurs consommateurs pour demain.
Mais pour moi, ce n’est pas du tout ça qui est le plus grave. Oui, il y a un problème d’appropriation des données, mais je vois au moins deux, voire trois risques beaucoup plus importants.
Le premier c’est le risque de dépendance dont je parlais tout à l’heure. Puisque ces outils-là ne sont pas chers et efficaces, on se tourne vers eux, on prend sa dose quotidienne de Google et de Facebook et on est bien content, donc on y retourne le lendemain, etc. Il y a clairement une dépendance qui se crée vis-à-vis de ces outils parce qu’ils sont pensés pour ça ; c’est le cas de Facebook qui a de très nombreux psychologues dans ses équipes salariées pour faire en sorte que vous soyez addict à Facebook, c’est ce qu’on appelle l’économie de l’attention.
Le deuxième risque, on l’a largement évoqué tout à l’heure, je ne reviens pas dessus, c’est le risque de prolétarisation, c’est-à-dire que finalement le numérique ça va être by Google, by Facebook ou by Apple. Un exemple très concret de ça c’est le matériel. Si demain il faut équiper les élèves d’ordinateurs ou de téléphones, je rappelle que rien que pour le téléphone il n’existe aujourd’hui quasiment plus que deux plateformes à savoir les iPhones par Apple et les téléphones Android et Android est un système de Google. Donc même si les constructeurs peuvent être variés — Google est aussi constructeur —, mais surtout il maintient quasiment 80 % du marché de la téléphonie en proposant Android. À partir du moment où ils font ça, nous devenons des prolétaires du numérique, nous ne savons plus comment ça fonctionne et nous ne savons pas faire notre propre système.
Le troisième risque, je pense que là aussi on est bien pour en parler, c’est finalement le risque que ces plateformes se substituent à l’État et là il y a un risque qui est complètement au cœur, d’ailleurs, du débat Stop-Covid où Google et Apple sont très fortement impliqués. La question qui se pose derrière c’est la plateformisation de l’État, là on l’a vue et ça ne date pas d’hier. Je pense que même avant le gouvernement Édouard Philippe et la présidence d’Emmanuel Macron on avait déjà ce problème-là, de « vous avez un problème, on va créer un numéro vert, une plateforme téléphonique. » Bon ! Maintenant on va vous faire des sites web sur lesquels vous pouvez venir, je ne sais pas, reporter un problème, des choses comme ça. Cette substitution des plateformes à l’État dit quelque chose du type d’économie, du type de société dans laquelle on vit.
Je pense vraiment qu’il est possible de construire nos propres infrastructures numériques, de faire nos propres logiciels libres. À Framasoft on a montré qu’à neuf salariés et avec un budget qui équivaut à 80 mètres d’autoroute on était totalement en capacité de fournir du service à 700 000 personnes. Si l’État avait souhaité développer des services numériques pour l’entièreté de la population française, il pouvait le faire. Donc il y a bien eu un choix politique.
On n’est pas uniquement sur une question d’appropriation des données, de risques pour les données, c’est un vrai risque mais, pour moi, il est beaucoup moins grave que les risques démocratiques et sociétaux que je viens d’évoquer.
Alexandre Schon : Super.
J’ai fini mes questions éducation, je vais passer à la suite, mais Sabine, si jamais tu as des éléments particuliers autour de l’éducation, ou pas ?
Sabine Rubin : Il me venait des idées. J’avais une question mais peut-être qu’elle est pareille à tout à l’heure, un peu hors sujet.
En matière d’éducation, je comprends bien qu’il y a tous les accès, tous les outils, tous les services que vous évoquiez. Je me souviens d’un article justement de Jean-Michel Blanquer, de janvier, où il parlait de l’école de 2049, du travail de l’être humain et de la machine, qu’il faut trouver l’harmonie entre l’humain et la machine. Et je me souviens que là il n’était plus simplement question de visioconférence ou d’autre chose, presque plus d’intelligence artificielle, si j’ai bien compris. C’est le logiciel qui aide l’enfant à écrire ; c’est toutes sortes de logiciels pédagogiques, je ne sais pas comment les appeler. Vous avez aussi un point de vue là-dessus, ce qui est autre chose je crois ?
Pierre-Yves Gosset : Oui, ça va encore plus loin. Effectivement cette question de : est-ce que, à un moment donné, on aurait des assistants sous forme d’intelligence artificielle qui nous assisteraient tout au long de la vie, etc. ?
Il y a deux choses. Premièrement est-ce que c’est ce monde-là qu’on souhaite ? Je ne suis pas sûr, si vous posez la question à quelqu’un dans la rue : est-ce que tu aurais envie que ça soit finalement une machine qui apprenne à tes enfants à lire et à écrire plutôt qu’un être humain ou toi directement ?
Encore une fois, il y a cette espèce de fantasme qui mettrait la machine au-dessus de tout. Là je renvoie aux travaux de Simondon sur la technique, à ceux de Foucault sur la surveillance, parce que, qui dit intelligence artificielle, dit surveillance aussi, donc les sociétés de contrôle deviennent totalement facilitées dans ce genre de société. Mon point de vue – ce n’est pas une question qu’on a traitée de façon très officielle au sein de l’association Framasoft –, mais il nous paraît assez évident qu’on ne va pas souhaiter une technologie pour la souhaiter. Là j’en reviens à citer un autre philosophe, Ivan Illich : « C’est quoi un outil convivial ? Un outil convivial c’est normalement un outil qui émancipe l’être humain, c’est un outil qui ne l’enferme pas, c’est un outil qui élargit son rayon d’action et c’est un outil qui ne le rend pas dépendant. » Donc la question vis-à-vis de la technologie dans un futur beaucoup plus lointain, pour moi on peut la ramener à cette question de la convivialité et non pas à une question de la performance, finalement, ou de l’efficacité.
Ça me rend assez triste qu’un ministre de l’Éducation envisage ça comme si c’était un horizon souhaitable, voire un horizon inévitable. Il peut, peut-être, basculer entre les deux ou hésiter entre les deux, en tout cas ça n’est ni l’un ni l’autre. Je pense que la crise qu’on vit en ce moment nous rappelle, de façon assez rude, que, effectivement, ce n’est peut-être pas l’horizon inévitable, qu’il va peut-être se passer d’autres choses. Je suis persuadé, en tout cas à titre personnel, que remplacer l’humain par la machine n’est pas un horizon souhaitable. Ça n’a jamais été ça. Ce qui fait le propre de l’homme c’est la technique, on est d’accord, s’il n’y avait pas la technique, et je ne parle pas que du numérique, le simple marteau, le burin, etc., nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui. S’il n’y avait pas eu l’imprimerie, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui. Mais la technique doit être souhaitée, désirée, acceptée et pensée par les humains et non pas par des entreprises qui vont vous dire, à un moment donné, qu’on peut remplacer 800 000 profs par une intelligence artificielle qui sera greffée dans le corps d’un être humain. En tout cas ça ne me paraît pas un horizon souhaitable.
Alexandre Schon : Juste une toute petite parenthèse avant de poser mes deux dernières questions.
Première chose : vous avez indiqué tout à l’heure que durant le confinement il y avait différentes associations qui ont un peu souffert de tout ça. Qu’est-ce qu’il en est, par exemple, des chatons ? Et juste définir, auprès des gens qui nous écoutent, qu’est-ce que c’est un chaton concrètement et le plus simplement possible. Après je vous poserai mes dernières questions. Si vous pouvez apporter quelques éléments assez rapidement.
Pierre-Yves Gosset : Un chaton, très rapidement, c’est une structure qui propose des services en ligne à destination des publics qui sont sur son territoire, c’est-à-dire que c’est un petit Framasoft. On aurait pu essaimer de façon complètement différente en créant une fédération Framasoft, etc., ce n’était pas notre choix. On souhaitait que chacun puisse créer sa propre structure, ça peut être un individu, ça peut être une petite entreprise, ça peut être une société coopérative d’intérêt collectif, ça peut être une association évidemment. Ces gens-là se réunissent, choisissent et écrivent leurs statuts ensemble et disent « OK, moi je vais proposer une petite partie de services en ligne et je vais rendre ça accessible, soit à tout le monde, soit uniquement à des publics qui vont adhérer à mon association, soit à des publics qui vont être en grande précarité, etc. » Donc chacun peut choisir un petit peu comment il va gérer cette structure-là. Finalement c’est un réseau d’hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
La deuxième partie de la question c’est est-ce qu’ils ont souffert ? La réponse est plutôt non. Au contraire, quand Framasoft était vraiment dans le tsunami de la pandémie, on a réussi à monter un site qui s’appelle entraide.chatons.org, chatons au pluriel, entraide.chatons.org8. C’est une page sur laquelle vous pouvez accéder à des services, typiquement un service de prise de notes collaboratif, un service de visio, etc., et plutôt que de proposer ceux de Framasoft, ça propose aléatoirement soit ceux de Framasoft soit ceux d’un des 10, 20 50 autres chatons qui proposent ce service-là, ce qui fait qu’au lieu d’aller sur une adresse et un service – aujourd’hui vous allez sur Google ou sur Facebook – vous allez chez les chatons et vous choisissez celui que vous voulez et voilà !
Les chatons sont des structures qui sont souvent toutes petites, donc qui n’ont pas trop souffert pour l’instant de l’épisode épidémique que l’on vit. Par contre, là où je suis inquiet en tant que militant associatif, c’est pour toutes les associations sur le terrain, les associations de l’urgence sociale, les associations d’éducation, les associations d’aide aux malades, etc., qui vivaient déjà difficilement parce que le flot de subventions s’était quand même bien tari ces dernières années et qu’on les avait mises en concurrence. Ce serait un tout autre débat et, si vous voulez, on pourrait partir sur le sujet de la question de la situation du milieu associatif en France qui s’est aggravée et est devenue presque catastrophique ces dernières années. Du coup, ces associations-là vont mettre la clef sous la porte. Pour moi il est relativement évident qu’un très grand nombre d’entre elles ne pourront pas se relever, notamment celles qui ont des salariés, ce qui ne représente pas loin de, quand même, plusieurs dizaines de milliers d’associations en France. Elles ne vont pas se relever et, du coup, elles vont laisser un espace vide dans lequel les gens vont être en souffrance et sur lequel, il y a d’assez fortes chances que l’État, tel que je le perçois actuellement, va arriver en disant « les associations ont échoué, on va donc mettre un modèle startup nation », et on va repartir exactement comme avant l’épidémie en disant « les associations ce n’est pas sérieux, ce qu’il faut c’est un modèle efficace. » Du coup, ma crainte, c’est que ces associations qui étaient un commun et du faire ensemble, de l’action le plus souvent bénévole, souffrent énormément des conséquences notamment économiques de la pandémie.
Alexandre Schon : Du coup, ça m’amène à mes deux dernières questions. Déjà la première : face aux solutions dites propriétaires qui sont souvent dépeintes, à juste titre, comme des solutions toxiques, pour vous quelle est, demain, la place de la licence libre, de la licence globale ? Quel modèle associatif, économique, coopératif, construire pour aider ces associations, ces entreprises qui feraient de la promotion du Libre, du vrai Libre, à grandir ? Comment les administrations ou les entreprises publiques peuvent aider directement ou indirectement au développement de ces outils ? Quelles compétences pourraient-elles mettre à disposition ou développer dans le processus de formation pour aider à faire émerger ce type d’acteurs ? Ça c’est ma première question.
Pierre-Yves Gosset : Je vais essayer de répondre à celle-là puisqu’elle est très vaste.
Les licences libres sont des textes juridiques qu’on accole par exemple à un logiciel pour dire ce logiciel est libre ou c’est un texte qu’on accole à un contenu pour dire, par exemple, cette photographie est sous licence libre donc vous avez le droit de la partager, de la modifier, de la redistribuer. Un prof, par exemple, peut très bien mettre son cours sous licence libre et dire « ça c’est mon cours de maths, vous avez le droit de le copier, de le modifier, de l’adapter à vos besoins, etc. » Je signale le travail plutôt exceptionnel d’une association qui s’appelle Sésamaths9 qui, depuis des années, produit des manuels sous licence libre.
Finalement, là encore, la question des modèles derrière les licences libres est très politique. On voit que le discours un petit peu there is no alternative qu’on a entendu pendant des années ne tient plus face à cette situation pandémique, donc il va falloir trouver une voie entre la gestion privée et le tout État et ça, finalement, c’est ce qu’on appelle les communs. Les communs ce sont des communautés multiples qui se fixent des règles pour partager et pérenniser des ressources communes. Ces communs, qui ont longtemps été oubliés, montrent que finalement, quand on fait confiance au niveau le plus local pour laisser les gens s’approprier une ressource commune et la faire vivre, il se passe des choses assez fabuleuses. Je rappelle qu’Internet, aujourd’hui, est un commun. C’était une blague des Guignols de l’info, je crois, Jacques Chirac qui disait « appelez-moi le président d’Internet ! » Il n’y a pas de président d’Internet. Il y a des créateurs, certes, mais aujourd’hui cette œuvre est partout. On est là sur quelque chose qui est distinct du public et qui est distinct du privé.
Ce que nous essayons vraiment de promouvoir comme système c’est ce qu’on appelle une société de contribution ; on emprunte beaucoup, là aussi, au philosophe Bernard Stiegler qui parle d’économie contributive. Je ne dis pas qu’on va plus loin, en tout cas on fait un pas de côté par rapport à sa proposition, en disant que dans cette société de contribution on a une alternative à la consommation qui est la participation au système dans lequel on est. Lorsqu’on produit quelque chose plutôt que ça soit tout de suite fermé, c’est-à-dire qu’on y mette un copyright, nous on y met plutôt un copyleft, ce qu’on appelle une « gauche d’auteur », c’est-à-dire qu’on permet aux gens de se réapproprier les œuvres. Et quand Framasoft développe un logiciel par exemple PeerTube10 qui est une alternative à YouTube, comme Mobilizon11 qui est une alternative aux évènements Facebook, quand on fait ça, par défaut on décide de le mettre dans des communs. Ce qui, je pense, est intéressant, ce qui pousse à ce type de démarche c’est quel est le type de société qu’on peut voir advenir si on fait ce choix-là.
Alexandre Schon : OK. Super.
Ma dernière question : plus généralement est-ce que dans la période qu’on est en train de vivre, puisque vous êtes une association qui parle aussi, aujourd’hui, des enjeux du numérique, est-ce que vous pensez qu’il y a une opportunité pour les gouvernements d’implanter une acceptation de la surveillance généralisée dans notre culture, à la vue de tout ce qui est Stop-Covid, etc., des drones, de la reconnaissance faciale ?
Pierre-Yves Gosset : La réponse est oui. La question de la surveillance existait bien avant le numérique. On a remplacé des fiches papier par du numérique et cette question de la surveillance informatisée est évidemment d’autant plus forte qu’elle donne cette illusion aux responsables politiques que, par le numérique, ils ont un outil qui permet finalement, via la surveillance, de contrôler les populations.
C’est une question hyper-large, du coup ça se bouscule un petit peu dans ma tête : est-ce qu’on prend l’angle Foucault, Surveiller et punir, à un moment donné ? Finalement c’est le rapport de confiance dont vous parliez tout à l’heure qui s’est un peu brisé ou abîmé entre les citoyens/citoyennes et les responsables politiques. C’est évident que ce n’est pas en mettant en place des outils de surveillance, quand bien même on les appelle, évidemment pour des raisons sémantiques, des outils de protection ; on appelle quand même maintenant les caméras de vidéosurveillance des caméras de vidéo-protection, tout ce discours-là est évidemment fait pour faire passer une acceptation. Quand vous téléchargez Stop-Covid, vous avez l’impression, c’est complètement voulu y compris jusque dans le monde de l’application, c’est complètement pensé pour vous faire dire « je participe à arrêter le virus » parce qu’on vous a fait peur, à juste titre, sur la question de la pandémie, du coup vous téléchargez l’application et vous apportez votre petite goutte d’eau à arrêter le virus. Or ce n’est pas le cas du tout. Ce que vous faites, c’est télécharger une application dont l’efficacité n’est absolument pas prouvée et démontrée, dont pas mal d’experts qu’ils soient informaticiens, épidémiologistes ou autres disent que ça ne va pas fonctionner parce que ça fonctionne sur du Bluetooth ; dans votre poche et derrière le mur, ça ne va pas du tout fonctionner de la même façon. Ce qui m’ennuie dans cette histoire Stop-Covid c’est que quoi qu’il arrive, quelque part j’ai envie de dire que le gouvernement a gagné : si Stop-Covid ne passe pas, il y aura eu un gros débat sur est-ce qu’il fallait cette application, est-ce qu’il ne la fallait, etc., donc on a fait avancer le niveau d’acceptation de cette solution ; si elle passe c’est la première voie pour une application Stop-Zad, Stop-Je ne sais pas quoi, Stop-Gilets jaunes, etc., je n’en sais rien.
C’est évidemment l’illusion, encore une fois, que le numérique va résoudre des problèmes qui sont finalement posés par des humains. Le numérique, en lui-même, ne résout rien. Il permet de faciliter un certain nombre de choses et, comme tout outil — là aussi je vais citer Bernard Stiegler — c’est un pharmakon, c'est-à-dire que c’est à la fois le remède et le poison. À un moment donné, il va falloir équilibrer sur quel type de numérique on veut, pour choisir, finalement, entre un numérique qui nous émancipe ou un numérique qui nous asservit.
Alexandre Schon : Super. Merci à vous.
On n’a pas eu le temps d’aborder le domaine commun informationnel, mais j’encourage beaucoup les gens qui nous écoutent à se renseigner sur cette notion qui est très importante pour l’avenir du numérique et, en tout cas, de la société, on l’espère.
On incite aussi les gens qui nous écoutent à faire un don à Framasoft le cas échéant, ça fait toujours plaisir.
Pierre-Yves Gosset : Merci.
Alexandre Schon : Sabine je te laisse conclure.
Sabine Rubin : Merci beaucoup. En tout cas moi j’ai beaucoup appris. Je n’aurais pas une audition tout de suite après, j’aurais encore deux trois questions à vous poser, du coup je le ferai ultérieurement si vous le voulez bien, notamment sur le modèle économique, je ne sais pas ou je n’ai pas compris.
Pierre-Yves Gosset : On n’a pas abordé le modèle économique.
Sabine Rubin : On n’a pas abordé ce sujet-là qui reste quand même une préoccupation.
Merci beaucoup, vraiment. Vous voyez que c’est justement quand on ne connaît pas un domaine, ça nous l’éclaire et je pense que c’est très intéressant de le comprendre à la fois politiquement mais aussi dans le cadre de l’éducation.
- 1. Framasoft
- 2. Numérique à l’école : partenariat entre le Ministère de l’Éducation nationale et Microsoft
- 3. WebLettres - Le portail de l'enseignement des lettres
- 4. Edward Snowden
- 5. Dégooglisons Internet
- 6. Contributopia
- 7. CHATONS
- 8. Services libres en ligne du collectif CHATONS
- 9. Sésamaths
- 10. PeerTube
- 11. Mobilizon