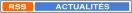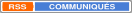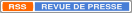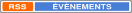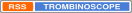De l'intérêt de ne pas demander la permission - Transcription du Décryptualité du 7 mai 2018
Titre : Décryptualité du 7 mai 2018 - De l'intérêt de ne pas demander la permission
Intervenant : Luc Fievet
Lieu : April - Studio d'enregistrement
Date : mai 2018
Durée : 14 min 50
Écouter ou télécharger le podcast
Revue de presse pour la semaine 18 de l'année 2018
Licence de la transcription : Verbatim
Illustration : Couverture du livre Richard Stallman et la révolution du logiciel libre licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
NB : transcription réalisée par nos soins. Les positions exprimées sont celles des personnes qui interviennent et ne rejoignent pas forcément celles de l'April.
Transcription
Luc : Décryptualité.
Voix off de Nico : Le podcast qui décrypte l’actualité des libertés numériques.
Luc : Semaine 18. Salut moi-même. Je suis tout seul. Grand week-end de mai et j’ai été abandonné par Mag et Manu. Nicolas ne peut pas venir, donc je vais tenter de faire le podcast de cette semaine tout seul, en espérant que ça marche et que j’arrive à garder le rythme. Manu n’est pas là, mais il a quand même fait une sélection d’articles, il n’y en pas beaucoup, il y en a quatre.
telos, « Les makerspaces: un petit coin de paradis technologique ? », point d'interrogation, un article de Monique Dagnaud. Il s’agit d’un article qui, en gros, est là surtout pour présenter la sortie d’un livre qui s’appelle Makers : enquête sur les laboratoires du changement social, écrit par Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie-Christine Bureau et Michel Lallement.
20 minutes online, « Cambridge Analytica annonce son sabordage », un article par la rédaction. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec le scandale lié à Cambridge Analytica. Ils sont sur le grill depuis un bon moment et, évidemment, leur activité est devenue totalement impossible, donc ils ont décidé de fermer boutique. On ne doute pas qu’ils reviennent sous une autre forme sans doute.
World Socialist Web Site, « Il y a 25 ans : Le code source du World Wide Web était rendu public », un article de la rédaction. Ça revient sur un anniversaire : en 1993, il y avait le code informatique qui permet de faire tourner le Web, en gros une fraction d’Internet. C’est Tim Berners-Lee, qu’on a évoqué ici plusieurs fois, qui, à l’époque avait motivé le CERN qui hébergeait ce projet, de le diffuser sous licence libre et, ce que dit l’article, c’est que ça avait contribué à son explosion : le fait que beaucoup d’acteurs puissent s’en emparer, développer leurs propres serveurs et que Internet puisse se monter de cette façon-là.
Le Monde Informatique, « Taxation des GAFA : pas de consensus européen en vue », un article de Nicolas Certes. Ça, c’est la mauvaise nouvelle. Ça fait un petit bout de temps qu’on sent qu’au niveau européen il y a une vraie volonté de mettre les GAFAM au pas et, notamment, de leur faire payer leurs impôts. Là, il y a eu des discussions et c’est un revirement de situation. On savait que certains pays, notamment ceux qui font leur beurre en faisant du dumping fiscal, étaient évidemment contre. Mais il y a eu un certain nombre de pays qui ont changé leur fusil d’épaule, notamment la Suède, la Finlande et le Danemark, et, par ailleurs, la Grande-Bretagne qui a carrément tourné casaque et l’Allemagne qui donne des signes de faiblesse. La France était assez énervée par ce truc-là. Il semblerait que sur ce sujet-là nos représentants sont en pointe et veulent vraiment taxer tout ça et en tout cas, là, manifestement, ça prend une mauvaise tournure.
Le sujet de la semaine, dont je voulais parler, c’est la question de demander ou pas la permission. C’est quelque chose qui est important dans les licences libres et dans la façon dont on les applique. Je rappelle, une licence libre est un texte juridique qu’on va appliquer sur une œuvre — le code informatique étant couvert par le droit d’auteur — et qui va donner un certain nombre de libertés et notamment, la liberté d’utiliser le code pour que ce qu’on veut, implicitement sans avoir à demander l’autorisation à l’auteur de le faire.
Ça peut paraître anodin, mais, en fait, il y a pas mal de conséquences à ça et la première c’est que ça simplifie énormément les choses quand on veut monter un projet quelconque ; ça les rend même possibles. C’est-à-dire que dans un logiciel qui va évoluer au fil du temps, etc., on va avoir un grand nombre d’auteurs, d’informaticiens, de codeurs qui vont se relayer et, au bout de peut-être dix ans, quinze ans, vingt ans – il y a des logiciels qui ont des durées de vie extrêmement longues –, c’est potentiellement des centaines ou des milliers de personnes qui sont passées dessus. Donc s’il fallait obtenir l’autorisation de tout ce monde-là, eh bien ce serait compliqué. Et puis, quand on a des logiciels, souvent ils sont développés avec un ensemble de briques, on va prendre d’autres logiciels et les assembler ensemble : une distribution GNU/Linux, donc le système d’exploitation qui va faire tourner un ordinateur, libre, lui ce sont des milliers de logiciels qui sont mis ensemble. Et si on imagine qu’il y a des tonnes de développeurs pour des milliers de logiciels, ce serait tout à fait impossible de demander l’autorisation à tout le monde. Donc pouvoir faire sans autorisation c’est plus que simplificateur, c’est également quelque chose qui rend possibles certains projets, même un grand nombre de projets.
Un des intérêts qu’il y a derrière c’est que, quand on autorise à faire ce qu’on veut et sans demander l’autorisation, eh bien les gens peuvent s’approprier le code pour faire ce qu’ils veulent et, notamment, des tas de choses auxquelles les auteurs originaux n’ont pas pensé ou ne souhaitent pas ce que ce soit utilisé. Donc du coup, on a cette liberté, cette facilité à faire et à faire différemment de ce qui a pu être fait jusqu’à maintenant. Donc ça va vraiment dans l’idée de plus de créativité, de plus de souplesse, alors qu’un éditeur qui va verrouiller son code ou donner des autorisations dans un sens ou dans un autre, va être limité par sa propre stratégie, par le fait qu’il ne peut pas être partout et qu’il n’aura pas l’imagination ou qu’il ne croira pas à un projet.
Dans notre revue de presse on avait la question de la libération du code du World Wide Web ; c’est la bonne illustration ; ça a été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en partageant le code.
Et l’autre chose que je trouve intéressante et qu’on mentionne finalement assez peu, c’est que ça fige dans le temps, en fait, la volonté de l’auteur. C’est-à-dire qu’un auteur, que ce soit pour du code informatique ou une œuvre, peu importe, mais qui mettrait son travail sous licence libre, cette licence est appliquée à la version, à la copie de l’œuvre au moment où ça a été fait. Et là-dessus, il peut revenir en arrière, mais disons que c’est un peu compliqué. Dans le droit français, notamment, il y a un droit moral qui est inaliénable, ça veut dire que l’auteur peut dire « non j’ai changé d’avis vous n’avez plus le droit de faire ceci, cela ». Mais dès lors qu’on a une notion de droit patrimonial, l’auteur peut faire jouer son droit moral à condition de dédommager les gens auprès de qui il aurait contractualisé le droit à exploiter son œuvre. Et, par rapport au Libre, on peut avoir cette interprétation qui est la plus crédible, même si elle n’a jamais été validée à ma connaissance par une jurisprudence, qui est de dire dès lors que l’auteur met une licence libre ça veut dire qu’il autorise, par défaut, l’exploitation, notamment commerciale, et donc s’il voulait revenir en arrière a posteriori, il faudrait qu’il dédommage tout le monde ; ça va être vite impossible à faire.
Du coup, on a comme ça une œuvre qui se détache de son auteur et il y un peu cette idée de désacralisation de l’auteur. Aujourd’hui, on est dans ce système où l’auteur est une sorte de dieu tout en disant que ça va dans le sens de sa reconnaissance, etc., mais, en fait, c’est bien souvent une arme à double tranchant.
Dans le domaine culturel, notamment, les gens, très naturellement, s’approprient la culture, s’approprient les choses, on fait des remix en musique, des mashups, des détournements ; les gens vont faire des fanfictions, font du jeu de rôle, peuvent se déguiser sous la forme de leur héros favori, en discutent, etc. Donc tout ça c’est naturel ; c’est comme ça qu’on s’approprie la culture et on voit, de temps en temps, des limites, c’est-à-dire que les ayants droit vont autoriser un petit peu mais pas trop. À certaines époques, ils ont voulu essayer de bloquer, puis ils se sont rendu compte que ce n’était pas très bon pour le commerce. Mais finalement, on perd pas mal de libertés par rapport à ça. La liberté du public s’efface très souvent face à l’auteur sacré qui, finalement, est une bonne façon de maîtriser l’œuvre et de s’approprier de son interprétation, de sa libre interprétation.
Il y a des exemples que moi je trouve assez parlants. Il y a, par exemple, Axanar. Axanar c’est une fanfiction de très haut niveau dans le monde de Star Trek. Pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek — enfin vous connaissez au moins un petit peu, c’est passé à la télé il y a fort longtemps — c’est un univers de science-fiction qui est assez intéressant parce qu’il est doublement utopique. C’est-à-dire que l’auteur qui l’avait créé dans les années 60 a ré-imaginé un avenir où l’humanité cesserait d’être en guerre et c’est une série qui a connu un succès énorme au niveau du public, elle avait une base de fans extrêmement forte. Et pendant presque dix ans, après que la série se soit arrêtée, elle n’a pas été très longue, des tas de gens ont écrit des livres et des choses comme ça et ont continué à faire vivre cet univers, indépendamment des ayants droit qui ne misaient pas beaucoup dessus, et le truc a continué à vivre.
Il y a quelques années, il y a eu une sorte de reboot, donc ils ont repris l’univers, ils ont recommencé à zéro, et ce reboot ne plaît pas à tous les fans. Et donc on a, aux États-Unis, un grand fan qui a réussi à collecter quelques millions de dollars pour faire une fanfiction et une fanfiction d’un niveau assez incroyable, en pouvant embaucher, notamment, d’anciens comédiens qui avaient joué dans la série. Du coup, évidemment, il s’est pris les studios qui lui ont autorisé à faire quelque chose mais beaucoup plus petit que ce qu’il voulait. Évidemment, lui entretient l’univers Star Trek d’avant le reboot, celui que les fans apprécient. On voit comment il peut y avoir un conflit entre l’appropriation de la culture d’un côté, les ayants droit qui veulent le faire tourner dans une autre direction.
Un autre exemple c’est Frank Zappa qui aurait dit sur son lit de mort — ce n’est pas vraiment sûr : « Jouez ma musique, que vous soyez musicien ou pas, jouez ma musique », qui a été compris comme une invitation à la jouer ; c’était quelqu’un qui était très attaché à la liberté artistique. Et il y a une guerre entre les gens qui s’approprient sa musique et la société de gestion des droits qui est gérée par sa femme derrière. On s’aperçoit qu’un auteur, c’est compliqué pour lui — sauf à passer par une licence libre — d’autoriser, comme ça, sa musique à être diffusée.
La raison pour laquelle c’est intéressant de voir cette désacralisation de l’auteur c’est que la propriété intellectuelle – un mouvement qui se développe depuis maintenant un paquet d’années, il y avait un journaliste que s’appelle Florent Latrive qui avait alerté là-dessus – se fait largement au détriment des droits du public. Il y a un texte assez connu qui est de Victor Hugo à l’époque où la gestion moderne des droits d’auteur a été mise en place, et qui avait dit : « Le droit du public devrait passer avant le droit des auteurs » ; et aujourd’hui on parle finalement très peu de cette question des droits du public.
On voit que cette idée de ne pas demander la permission, de dire « vas-y, fais-le et tout ce que tu peux en faire m’échappe », va, évidemment, dans une logique totalement inverse à cette question du contrôle.
Si on revient sur la question de l’informatique et des licences libres, un des arguments qui revient souvent c’est de dire « oui, mais c’est juridiquement complexe ». Des licences libres il y en a un certain nombre, sans doute trop, mais elles sont relativement standardisées, les plus courantes on peut finir par les connaître ; alors ce n’est pas hyper-simple, évidemment, c’est du droit, mais tout le monde va utiliser un certain nombre de licences ; il y en a peut-être une dizaine qui sont utilisées couramment et on peut se dire qu’on peut monter en compétences là-dessus et avoir une idée de comment ça marche.
Face à ça, dans le monde propriétaire on a les CGU, les conditions d’utilisation, celles qu’on clique en bas de l’article, quand on installe un logiciel ou qu’on va sur un nouveau service, qui sont toutes différentes, qui sont interminables et qui ont potentiellement des clauses illégales parce qu’une société peut se dire que ça ne lui coûte pas grand-chose de mettre une clause illégale ; ça va écarter un certain nombre de gens ; et puis, si on veut leur prouver qu’ils ont tort, il faudra les traîner au tribunal, il va falloir avoir les moyens et c’est un filtre économique pour empêcher le tout-venant d’avoir, finalement, accès à ses droits. Et quand on va parler des complexités des licences libres, les différentes licences propriétaires, il y en a une foule, c’est fait pour ne pas être compris ou c’est fait pour favoriser une politique commerciale. Enfin on vit sur une sorte de fiction !
Dans l’affaire de Cambridge Analytica, qu’on mentionnait pendant la revue de presse, il s’est avéré que Facebook a admis un moment, dans toutes les discussions, qu’il ne lisait pas et ne connaissait pas les conditions d’utilisation des boîtes qui récupéraient ces données, à qui il donnait les données.
L’autre point, c’est que l’exercice de la surveillance, dans le monde propriétaire, c’est lourd. Gérer des licences ça a un coût parce qu’il faut s’assurer qu’on est bien à jour, que untel et untel n’ont pas installé de logiciels sans demander l’autorisation, etc. Manu n’est pas là, mais il aime bien cet exemple : il y a eu, il y a quelques années, des DSI de très grosses boîtes qui se sont plaints d’Oracle ; Oracle c’est la grosse machine en termes de base de données, parce que dans leur licence il est dit qu’ils peuvent venir pour faire un audit et que les exigences, en termes d’informations à donner, sont telles que ça représente plusieurs personnes à temps plein et, qu’en gros, ça avait coûté à ces entreprises-là une véritable fortune pour donner satisfaction à leur fournisseur.
Un autre point qu’on peut avoir dans le monde propriétaire, et qui freine cette idée de demander l’autorisation, c’est tout ce qui est brevets. On l’a répété souvent dans ce podcast : en Europe, les brevets logiciels sont censés ne pas être légaux, mais c’est un petit peu plus compliqué que ça et on voit, hors Europe, qu’il s’est monté ce qu’on appelle des pools de brevets, c’est-à-dire des associations de grosses entreprises ou de plus petites, qui mettent tous leurs brevets ensemble pour pouvoir faire masse et pour pouvoir négocier les uns avec les autres. Il y a tellement de brevets dans tous les sens que, en fait, c’est, là encore, ingérable ; c’est comme les multiples conditions d’utilisation qu’on n’arrive pas à lire. On ne peut pas savoir, ou difficilement savoir, si on va mettre les pieds sur quelque chose qui a été breveté, sachant qu’il y a des tas de gens qui brevettent des trucs qui sont totalement « imbrevettable » ; mais là encore, il faut partir dans une procédure pour pouvoir le faire valoir. Du coup, on se retrouve dans une situation où l’auteur, le génial inventeur — la formule qu’on aime bien utiliser — finalement, sa propriété intellectuelle est complètement noyée dans un rapport de forces où ce ne sont que les gros qui ont les moyens de mettre l’argent sur la table et de se payer un nombre de brevets suffisants pour que l’adversaire soit lui-même en train d’empiéter les brevets qui, finalement, ramassent la mise. Et là encore, on se retrouve avec un système où ce sont les plus lourds et les plus gros qui dominent et où la propriété intellectuelle, le brevet, etc., qui est censé protéger, au final devient un outil d’asservissement.
On a également, contre cette facilité de ne pas demander la permission, la notion de la protection par la marque. Et c’est quelque chose qui a tout à fait cours dans le monde du Libre, puisque la plupart des logiciels ou des projets déposent leur marque. Le code est libre mais la marque ne l’est pas. Firefox est assez connu pour avoir beaucoup joué avec ça. On se rappelle aussi qu’Apple avait joué avec les designs, quand il y avait eu des concurrents pour l’ìPad, en disant telle forme, etc., c’est mon identité. Donc on a tout un terrain d’enjeux sur la question de la notoriété.
Ce qui me fait penser à une petite vidéo que nous avions faite avec Mag et Manu pour parler des DRM dans les e-books1, notamment. On a fait une petite vidéo comme ça, qui est passée sur le site de l’April, et quelqu’un l’a mise sur YouTube, chose que nous n’avions faite. De fait, ça a donné un bon boost à cette vidéo. Des gens m’en ont parlé. Mais en même temps, en faisant ça, cette personne a finalement donné à YouTube des droits de revente, de « relicenciation » de notre vidéo, sans nous en demander l’autorisation, c’est-à-dire en ne respectant pas la licence libre. Donc ça démontre comment, pour pouvoir être connu, il faut finalement céder un certain nombre de droits, notamment des droits d’auteur, pour pouvoir être visible auprès du public. C’est-à-dire qu’on a des YouTube, des Facebook, d’autres canaux qui ont cette force, cette puissance, cette capacité à toucher du monde. La question c’est l’image du tuyau, qui tient le tuyau qui va permettre d’arroser un maximum de personnes et, quand on veut exister sur ces réseaux-là, eh bien il faut payer, au moins en cédant son droit d’auteur. L’avantage qu’il y a avec un YouTube ou un Facebook c’est qu’ils n’interdisent pas aux gens d’exploiter leur travail ailleurs. Si on va chez un éditeur classique ou dans la presse, etc., ce n’est pas nécessairement le cas, on va être contraint par un système qui va nous interdire de faire ce qu’on veut de l’œuvre et les gens qui vont pouvoir la lire ne feront pas, non plus, ce qu’ils en veulent.
Voilà. Donc c’est une sorte de tour d’horizon qui montre que pouvoir faire ce qu’on veut d’un œuvre, sans demander l’autorisation, ça implique énormément de choses et ça nécessite, finalement, de l’indépendance. Cette dernière question de la notoriété et du contrôle des tuyaux démontre également tout l’intérêt qu’il y a à avoir des médias qu’on puisse contrôler soi-même, comme des radios locales qui diffuseraient un podcast sur les libertés informatiques en général, et qu’il est très important de partager entre-soi pour pouvoir exister en dehors de ces systèmes-là et pour pouvoir exercer nos droits à faire sans demander la permission.
J’espère que ce long monologue n’aura pas été trop fatigant. On se retrouve la semaine prochaine avec un peu plus de monde derrière le micro.